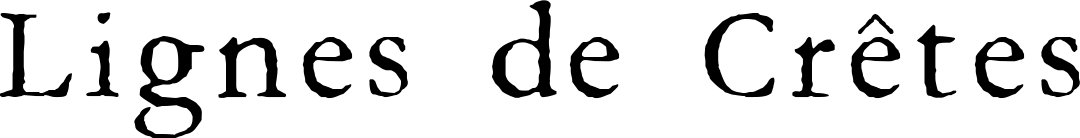Depuis la fin décembre 2025, l’Iran est secoué par une insurrection populaire d’ampleur nationale. Partie des ruelles du Grand Bazar de Téhéran, elle s’est rapidement propagée aux grandes villes et aux provinces, entraînant commerçants, étudiants, travailleurs et classes populaires dans un même mouvement. Les premiers mots d’ordre portaient sur ce qui, partout ailleurs dans le monde, déclenche les colères sociales : inflation galopante, effondrement du rial, explosion du prix des denrées, disparition de toute sécurité économique. Très vite, pourtant, la révolte a débordé ce cadre pour devenir une contestation globale du pouvoir politique, économique et social.
Ce soulèvement rappelle une évidence trop souvent oubliée par les commentaires occidentaux : il est impossible de séparer la lutte pour la survie matérielle de la lutte pour la liberté politique.
La “révolte du pain” : fondement matériel de quasiment toute insurrection
Les premières étincelles sont venues d’un espace longtemps perçu comme conservateur : le bazar. Commerçants et artisans, pilier historique de l’économie iranienne, ont fermé boutique et pris la rue et on ne peut clairement pas les accuser d’un goût prononcé de l’agitation. La raison était bien plus simple : la misère gagnait leurs foyers, leurs employés et leurs clients. La dévaluation brutale de la monnaie, la perte du pouvoir d’achat et l’effondrement des perspectives ont mis en évidence que l’ordre économique existant ne protège plus personne, pas même ceux qui en étaient autrefois les relais les plus fidèles. C’est un fait.
Cependant, réduire ce que ce mouvement deviendrait au fil du temps à une simple « crise du coût de la vie » serait une erreur, certes. Ne pas comprendre son hétérogénéité, aussi. Mais refuser d’y voir une révolte matérielle serait une falsification encore plus grave. La lutte pour le pain n’est pas un prélude honteux à la politique : elle en est l’une des formes premières. L’insécurité économique n’est pas un décor secondaire de l’oppression iranienne ; elle en est l’un des instruments centraux. Hélas, le voir là-bas, c’est aussi, à une autre échelle et dans un contexte différent sur la forme, l’admettre ici et ailleurs. La bourgeoisie occidentale et ses chiens de garde veillent à ce que ça ne soit pas le cas.
Liberté abstraite et cécité occidentale
Face à cette réalité, une partie des discours médiatiques et politiques occidentaux s’emploie donc à réordonner la colère iranienne selon des catégories lui correspondant davantage ici. La révolte serait avant tout une « quête de liberté » contre l’autoritarisme religieux ; les causes économiques, elles, relèveraient du contexte, de l’arrière-plan, presque de l’anecdotique.
Cette hiérarchisation n’est pas neutre. Elle correspond à une vision libérale et bourgeoise de la liberté, profondément marquée par la position sociale de ceux qui l’énoncent. Dans les démocraties occidentales, il est plus confortable de célébrer certaines luttes, soigneusement sélectionnées au préalable, pour les droits civiques, la liberté d’expression ou l’émancipation culturelle que d’affronter ce que disent réellement les soulèvements populaires : que la liberté est vide lorsqu’elle ne garantit pas les conditions matérielles de l’existence. Comme la démocratie n’est que de façade si elle ne garantit pas les conditions matérielles de participation politique réelle des masses.
Ce prisme ne produit que des illusions. L’une d’elles consiste à considérer la liberté comme une affaire d’idées, de symboles et de valeurs, détachée des salaires, du logement, de l’accès à la nourriture ou aux soins. Or, pour des millions d’Iraniens, la domination politique – par la classe bourgeoise natio-cléricale intérieure comme par les politiques impérialistes extérieures – se vit aussi dans la précarité quotidienne et dans l’impossibilité de vivre dignement.
La police libérale de la colère
C’est dans ce contexte qu’interviennent énormément de prises de positions politiques, d’Éditos comme d’analyses partielles et partiales qui, au mieux relativisent, au pire nient, le caractère économique de soulèvement en Iran, et même son autonomie. La prise de position de Kamel Daoud notamment dans une tribune publiée dans Le Point va, sans surprise, dans le même sens.
Sous couvert de défendre la dignité politique du peuple iranien, Daoud s’en prend frontalement aux analyses économiques du soulèvement, qu’il qualifie d’« explication alimentaire », allant jusqu’à y voir une forme de condescendance, voire de « racisme feutré ». En lisant Daoud parler de « condescendance » et de « racisme feutré » de quelqu’un d’autre, on pourrait presque se demander s’il s’agit d’une tribune ou d’une assignation pour le plagiat. S’il dénonce, ou veut en garder le monopole, y compris sur celui du plagiat.
Blague à part, l’argument mérite d’être pris au sérieux — précisément pour ce qu’il révèle – et c’est la seule chose qui est importante dans le contexte français. Car ce que Daoud choisit d’invisibiliser, c’est que la séparation entre liberté politique et condition matérielle est clairement un privilège de classe. Il faut n’avoir jamais connu la précarité structurelle pour croire que lutter contre la pauvreté ne relève pas d’une lutte pour la liberté. Il faut être protégé de la faim pour imaginer que le pain serait un sujet secondaire, presque indigne du politique.
En dénonçant les analyses matérialistes comme réductrices, Daoud ne défend pas une émancipation plus exigeante ; il reconduit, en bon chien de garde de la bourgeoisie et sa démocratie impériale, une hiérarchie libérale des luttes où seules les revendications formulées dans un langage abstrait, moral ou culturel sont jugées nobles par les « démocraties » occidentales. La liberté devient alors un concept désincarné, comme le concept de la « démocratie représentative», acceptable précisément parce qu’il ne remet pas en cause les structures économiques — ni en Iran, ni en France, ni ailleurs à l’échelle mondiale.
L’économie comme instrument de domination et les Libertés réelles
Ce sont précisément les conditions économiques — capitalisme, corruption, captation des richesses par les élites politico-religieuses, sanctions économiques internationales (souvent absentes des analyses occidentales) et destruction du pouvoir d’achat — qui rendent l’oppression iranienne totale, quotidienne, inévitable. Ne pas pouvoir se nourrir, se soigner ou se projeter n’est pas un simple « contexte » de la domination et son arrière-plan totalement secondaire par rapport à d’autres types d’oppression et de répression subies par la population.
Accuser les analyses matérialistes de réduire les Iraniens à leurs « ventres » relève d’un renversement classique : reprocher à ceux qui prennent la misère au sérieux de manquer de respect, tout en refusant d’en faire un objet politique central. Or, ce n’est pas parler du pain qui est condescendant ; c’est parler de liberté en faisant abstraction des conditions de ceux à qui elle est matériellement refusée.
Les révoltes iraniennes montrent une vérité que les discours dominants occidentaux ne veulent surtout pas admettre. C’est le fait que la liberté commence réellement là où la pauvreté cesse d’être une “fatalité” organisée. Elle commence quand vivre ne se résume plus à endurer. Les libertés ce n’est pas ce que les discours prétendent mais ce que le vécu est réellement. Les manifestants iraniens n’opposent pas lutte économique et lutte politique ; ils les articulent, parce que leur expérience quotidienne leur a appris qu’il n’y a pas de liberté possible dans le dénuement systémique.
Si ce message dérange, c’est parce qu’il met à nu ce qu’on nous vend comme une certitude confortable Celle selon laquelle la liberté pourrait exister indépendamment des rapports de classe. En Iran comme ailleurs, la révolte rappelle une évidence matérialiste : l’émancipation humaine est indivisible. Elle inclut le droit à la parole – d’ailleurs, bien plus réel pour Kamel Daoud que tous les sans-abris de Dunkerque à Perpignan mis ensemble – mais aussi le droit de manger, de se loger, de vivre sans peur du lendemain. C’est important. En parler est crucial.
Et s’il faut encore le rappeler, c’est peut-être parce qu’il n’y a, décidément, que pour la bourgeoisie occidentale que lutter pour le pain n’est pas lutter pour la liberté