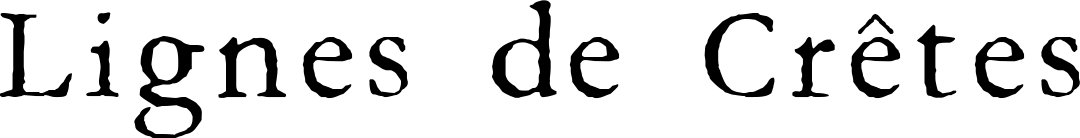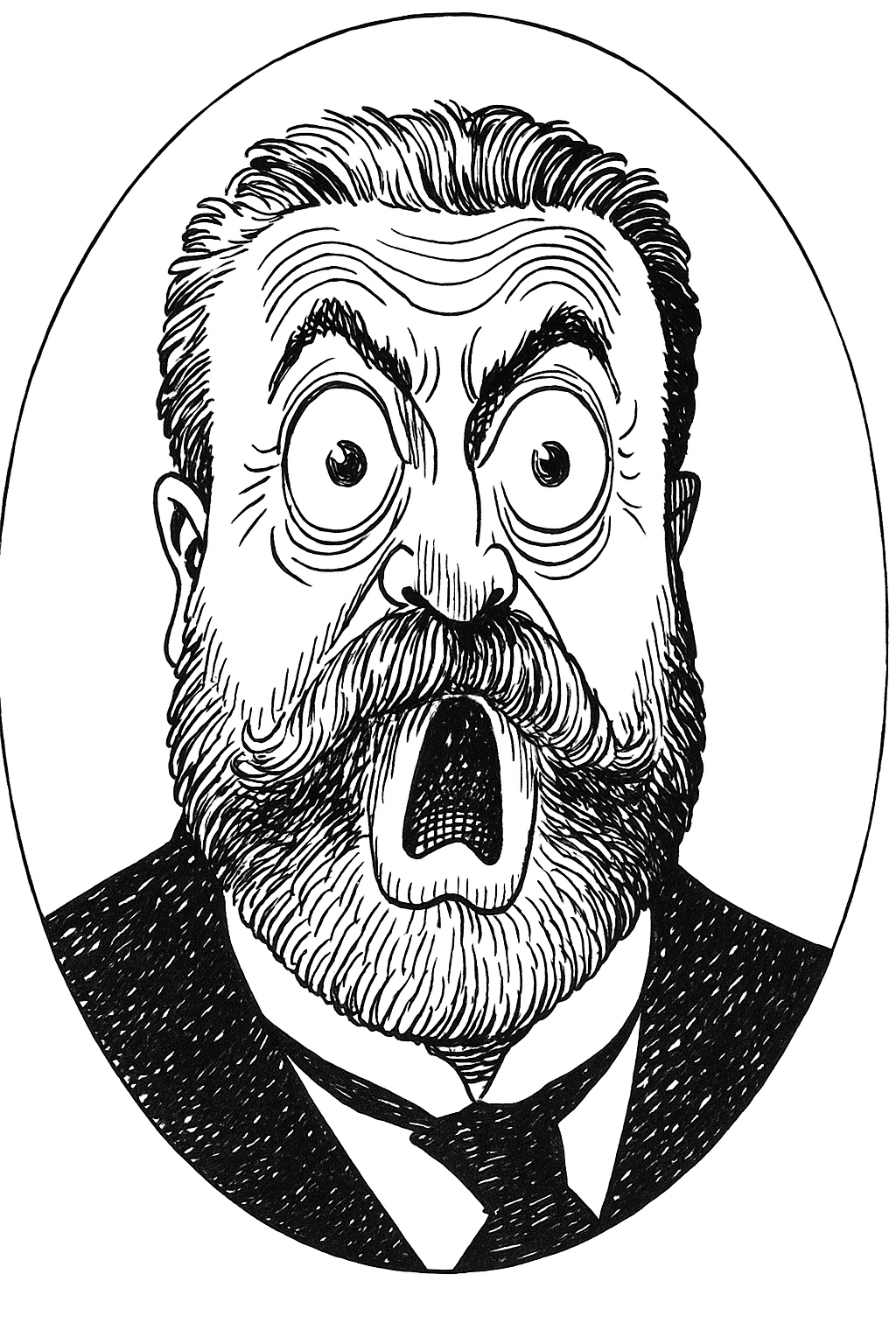Alors que les analyses sur le naufrage de la gauche française et européenne s’accumulent, entre aggiornamento conservateur et progressisme d’apparat, le fossé avec les classes populaires n’a jamais été aussi profond. Le dernier rapport de la Fondation Jean-Jaurès, qui promeut une “troisième gauche, post-sociétale”, et la tribune de Chloé Ridel en réaction, qui tente d’en sauver “l’honneur”, en sont les symptômes : deux réponses en apparence opposées, mais qui s’enferment dans les mêmes impasses. Derrière leurs différences de strict vocabulaire, elles reconduisent toutes deux un cadre technocratique, centralisé, souvent aveugle à ses propres biais — notamment ce suprématisme occidental qui persiste à désigner les normes dominantes comme neutres, et les identités subalternes comme problèmes à intégrer.
Dans une période où la méfiance envers le politique atteint un niveau historique, en particulier chez les minorités les plus exposées aux injustices, ces approches ne font qu’alimenter le désaveu. Quelques ajustements idéologiques n’y changent grand-chose. Peut-on encore croire que la gauche pourra se reconstruire sans remettre en cause ses propres angles morts, sans affronter la défiance dont elle est l’objet, et sans se défaire de sa prétention à incarner à elle seule – par ses think-tank, “ses personnalités”, et ses appareils – le progrès, quel qu’il soit ?
Face à ces impasses, il ne s’agit plus d’attendre des partis, mais de peser sur eux. Ce sont les expériences collectives, les solidarités concrètes et l’autonomie des mouvements sociaux qui peuvent dessiner un horizon qui rime avec autre chose qu’un énième échec. Bien plus que les états-majors et leurs cénacles.
Il n’y a aucune solution prête à l’emploi, mais une question: Que faire ?
Le rapport de la Fondation Jean-Jaurès : Un aggiornamento conservateur qui acte la défaite
Les auteurs du nouveau rapport “La troisième gauche” de la Fondation Jean Jaurès voulaient lui donner un air de Manifeste. D’ailleurs il commence par “Un spectre hante l’Europe…” et est parsemé par les citations de Marx et d’Engels. Mais la comparaison s’arrêtera à ces quelques mots. L’analyse de classe n’est utilisée, dans l’abus, que pour contrer les analyses basées sur la racialisation, le genre ou bien l’écologie.
Le rapport sur l’émergence d’une gauche post-sociétale, dirigé par Renaud Large, dresse un constat pourtant lucide : la gauche européenne a perdu, volontairement et consciemment ou pas, son lien avec les classes populaires, a déserté les territoires et a échoué à articuler le social, la souveraineté et la sécurité, ce qui aurait, selon la Fondation, dû être sa stratégie. C’est justement là le leitmotiv de ce rapport qui, au fil de la lecture, perd lui-même tout lien avec la pensée émancipatrice. Plutôt que d’en tirer une leçon d’écoute et de transformation, le rapport propose une adaptation stratégique aux tendances droitières de l’opinion. Sous couvert de « post-sociétal », il propose une gauche qui assume un patriotisme culturel, une ligne migratoire dure, une laïcité répressive et un retour à l’ordre, tout en conservant un socle social minimal.
Ce constat n’est pas un tournant et surtout pour le PS qui a signé la reddition il y a bien longtemps. Mais, il devient très dangereux dès lors qu’ il se présente comme un outil stratégique qui légitime les thèses de la droite dure et de l’extrême-droite au lieu de les combattre, et naturalise les paniques morales et sécuritaires au lieu d’en dévoiler les logiques de pouvoir. Il acte le renoncement à toute visée transformatrice, au profit d’une gestion modérée de l’inacceptable.
En d’autres termes, le rapport propose de coller au « réel » tel qu’il est perçu par les sondeurs : c’est-à-dire à une opinion publique présentée comme en attente d’ordre, d’autorité, de régulation migratoire et de souveraineté. Ils abandonnent même la stratégie classique de cette gauche paternaliste qui consiste à “expliquer, à convaincre ou à structurer un camp social”, en niant son autonomie. Ils proposent, en partant du constat que la population est réactionnaire, tout simplement d’accompagner les peurs, d’habiller de mots de gauche des idées de droite, et de sacrifier les luttes émancipatrices jugées trop « bourgeoises ».
Les luttes et les mouvements sociaux ne sont que ébranlés dans le rapport. Ils n’intéressent les auteurs seulement dans la limite permettant de constater leur échec. Les combats antiracistes et féministes sont ainsi “dépassés”. Les luttes écologiques sont “bourgeoises”. Et les mouvements sociaux comme celui de “Gilets Jaunes” a échoué seulement parce que la “gauche”, entendre le PS, n’en est pas tenu compte. On en est donc à nier la capacité de stratégie et l’autonomie d’un mouvement jusqu’à la responsabilité de son échec : “rien n’est possible sans la Gauche”.
Pour conclure, ce que propose le rapport d’une manière très crue, c’est en réalité un aggiornamento gestionnaire, un ajustement marketing aux tendances droitières de l’opinion publique. Pour le dire très crûment, le problème pour la gauche, ce n’est pas la montée de l’extrême-droite : c’est le fait de ne pas se donner assez de moyens pour lui ressembler, lacune que la “troisième gauche post-coloniale” devrait, selon les auteurs, balayer.
Chloé Ridel : un nouveau visage de l’opposition du PS trompeuse
Dans une tribune, dans Nouvel Obs, publiée en réaction, Chloé Ridel, eurodéputée et porte-parole du PS, s’oppose à cette orientation « conservatrice ». Elle défend une gauche plus fidèle à ses valeurs – sociale, féministe, antiraciste, écologiste – bien que cette fidélité en ce qui concerne le PS est plus que discutable. Elle appelle, d’ailleurs, à assumer une politique de sécurité et d’immigration « républicaine », à réinvestir les services publics et à articuler l’écologie à la lutte contre les inégalités.
Sur le papier, Chloé Ridel considère que cette position semble plus acceptable. Mais là encore, le vernis progressiste ne doit pas faire oublier la réalité politique.
Chloé Ridel appartient à un Parti socialiste qui a trahi à de multiples reprises les classes populaires, en menant des politiques d’austérité, en précarisant les services publics, en criminalisant les quartiers populaires, en adoptant des lois sécuritaires, en se ralliant au consensus néolibéral européen. Nous ne sommes pas obligés d’aller jusqu’aux trahisons de 1983. On ne peut pas oublier le quinquennat Hollande, pas si lointain que ça. On ne peut pas cacher sous le tapis la loi Travail, l’état d’urgence permanent, toutes les autres mesures liberticides et autoritaires, jusqu’au permis de tuer accordé à la Police par Bernard Cazeneuve ce qui a triplé le nombre de tués par les policiers ces dernières années, comme la mort de jeune Nahel dont on vient de marquer le triste deuxième anniversaire … Tout cela ne peut être effacé par quelques mots bien choisis et posés dans une tribune.
Et pourtant, beaucoup, même sans être au PS, voudraient bien les effacer. Ce n’est pas sans me rappeler les mots écrits récemment par un camarade dans son texte “La France n’est pas de droite, ce sont les partis qui ne voient plus la gauche !” sur Lignes de Crêtes : “…les « unionistes », attachés à l’union coûte-que-coûte au sein du NFP, assènent depuis la victoire du gouvernement Bayrou à ceux qui à gauche critiquent la énième trahison du PS que « la France étant à droite, on a besoin de toutes les gauches, y compris du PS ». Qu’il faudrait surtout ne pas en tenir rigueur aux socialistes, et que la priorité serait de ne pas « se » diviser, c’est-à-dire ne pas opposer les partis entre eux. Faire consensus, être raisonnable, et accepter la dérive droitière d’une composante du NFP.”
Parce que cette dérive droitière ne fait pas seulement partie du passé mais aussi du présent. Le discours du PS qui revient sur l’engagement programmatique du NFP de revenir sur la retraite à 62 ans ainsi que le refus de censurer le gouvernement Bayrou en sont les symptômes. Pendant que Chloé Ridel parle dans sa tribune de l’importance de “la démocratie et du pouvoir de peuple”, en réalité sa formation politique vote dans l’hémicycle avec la macronie et l’extrême-droite une loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement qui limite tous les recours des tiers, suspend de fait les règles juridiques et laissent aux Maires et surtout aux Préfets le pouvoir décisionnel par dérogation. Un véritable appel aux dérives et à la corruption.
Plus encore, la prétendue « nuance » de Chloé Ridel sur les questions migratoires ou de sécurité révèle en creux un glissement assumé vers une rhétorique identitaire, masquée par des références à la République. Elle parle d’assumer le « patriotisme », de « maîtrise des frontières », de « cohésion nationale ». Mais ce vocabulaire, dans le contexte actuel, alimente plus qu’il ne déconstruit le récit de l’extrême droite. D’ailleurs, la porte-parole du Parti Socialiste censée présenter un nouveau visage du parti, tronque la célèbre citation de Rocard en ne gardant que la partie “Nous ne pouvons accueillir toute la misère du monde”, comme n’importe quel élu de Droite extrême ou de l’Extrême-Droite le ferait. Ce n’est pas une alternative : c’est une autre forme d’adaptation, plus douce peut-être, mais tout aussi dangereuse.
La critique de multiculturalisme en leitmotiv de Suprématisme occidental et Angle mort postcolonial
Ce qui relie, en profondeur, la critique du multiculturalisme dans le rapport de la Fondation Jean-Jaurès et la défense républicaine de Chloé Ridel, c’est une même vision occidentalo-centrée : l’universalisme abstrait forgé par des siècles de domination occidentale, l’histoire coloniale, et qui continue de structurer les imaginaires politiques, même à gauche. Qu’ils en soient conscients ou non, leurs positions s’inscrivent dans un cadre suprématiste qui valorise les normes occidentales — blanches, bourgeoises, européennes, laïques — comme seuls repères.
Le rapport dénonce, par des exemples qui ne prouvent pas grand chose, le « multiculturalisme » comme une dérive communautariste, source de divisions, incapable de garantir la cohésion sociale. Chloé Ridel, sans utiliser le terme, s’inscrit dans la même logique lorsqu’elle appelle à « réussir l’intégration » à travers l’apprentissage de la langue, des valeurs républicaines, et le démantèlement des ghettos. Dans les deux cas, la norme implicite est claire : c’est à « l’autre » de s’ajuster à une identité nationale homogène, imaginée comme neutre, rationnelle et universelle — mais qui est en réalité un héritage racial, culturel et colonial.
Or, cette fiction d’un espace politique vierge, dans lequel chacun pourrait simplement « entrer » à condition d’en accepter les règles, est profondément mensongère. Elle nie l’histoire coloniale de la République, les discriminations systémiques, la racialisation des rapports sociaux, les asymétries économiques et symboliques héritées. Elle invisibilise les rapports de pouvoir dans les institutions, les récits médiatiques, l’école, la police, la justice, l’accès au logement, à la santé, au travail. Elle transforme la violence historique de l’État en exigence de loyauté.
En cela, le « post-sociétal » comme le « républicain » s’inscrivent dans une même matrice suprématiste occidentale, qui continue de dicter les cadres d’analyse et les stratégies. Ce biais est d’autant plus dangereux qu’il se déguise en bon sens, en modération ou en pragmatisme. Il empêche de comprendre pourquoi une partie croissante des classes populaires racisées ne se reconnaît plus du tout dans la gauche dite universaliste, et le vit comme une négation de leur vécu.
Loin de créer l’unité, cet universalisme abstrait alimente le ressentiment, creuse les fractures, et nourrit la défiance. Il empêche aussi d’articuler une véritable stratégie populaire inclusive, capable de penser l’égalité sans assimilation, la justice sans effacement, la République sans hiérarchie culturelle. Bref, il rend impossible tout projet politique réellement antiraciste, populaire et émancipateur.
Il serait très malhonnête de ma part de garder un semblant de lien exclusif entre ce fond suprématiste et le seul Parti Socialiste et son think tank. En réalité, on trouvera les résidus de ce fond idéologique chez des hommes politiques comme Roussel ou Ruffin comme Clémentine Autain ou Raphaël Gluksmann, quand bien même dans un registre plus européiste.
Finalement, L’Après ne veut dire autre chose que continuer comme avant et “Debout” tient tant qu’on reste à genoux. La fondation Jean Jaurès l’a bien compris et joue la carte de la refondation d’une alliance politique sur cette nouvelle Place Publique ouvertement autoritaire, identitaire et économiquement souverainiste. Le PS et le PCF de Roussel sont idéalement situés pour jouer à ce jeu.
Et maintenant, que faire ?
Au fond, qui croit encore que les débats internes à la gauche institutionnelle — entre aile sécuritaire et aile républicaine, entre « post-sociétal » et « progressisme intégré » — intéressent vraiment celles et ceux qui en subissent les conséquences ? Qui imagine encore que la réponse aux crises démocratiques, sociales, climatiques et raciales passera par un subtil réajustement idéologique dans un think tank, ou un repositionnement stratégique à gauche de la gauche ? En réalité, bien que les militant·es doivent en être conscient·es et adapter leurs stratégie et tactiques, dans la population elle-même, ces débats de couloirs n’intéressent déjà plus grand monde.
Les chiffres sont là, et ils sont brutaux. Selon une enquête, qui comme toutes les enquêtes vaut ce qu’elle vaut, Cevipof pour Public Sénat (février 2025), 74 % des Français pensent que les élus agissent pour leurs propres intérêts et sont corrompus. 78 % les jugent illégitimes. Et seulement 24 % font confiance au Parlement. Comment ignorer ce séisme démocratique ? Et surtout : qui peut croire qu’on pourra reconstruire quelque chose sur ces ruines avec les mêmes logiques, les mêmes appareils, les mêmes récits ?
La question se pose alors avec plus d’acuité encore pour les minorités — racisées, exilées, précarisées, sur-policiées, invisibilisées. Par exemple, la population qui est la plus ciblée actuellement : les musulman·es, que lui reste-t-il à attendre d’une gauche qui ne sait plus qu’invoquer des « valeurs républicaines » en guise de projet, quand ces valeurs leur ont si souvent servi de bâillon ? Que peuvent-elles espérer d’une classe politique qui les convoque comme symbole, tout en votant les lois qui les contrôlent, les expulsent ou les discriminent ?
Mais aussi — et surtout — quelles voies pourraient-elles tracer elles-mêmes ?
Quel rôle peuvent jouer les communautés, dont la communauté musulmane, les collectifs antiracistes, les mouvements féministes populaires, les luttes territoriales, les formes d’auto-organisation qui fleurissent en dehors des cadres classiques ?
Peut-on encore croire qu’une « recomposition de la gauche » suffira à répondre à l’exigence d’égalité réelle ?
Ou faut-il aller plus loin : penser une autonomie politique qui ne se contente plus d’attendre l’inclusion, mais qui invente ses propres conditions de légitimité, ses propres langages, ses propres outils de pouvoir ?
La gauche peut-elle encore être un espace d’émancipation si elle refuse d’entendre ceux qu’elle prétend défendre ?
Peut-elle encore parler de démocratie sans reconnaître l’ampleur de la défiance, ni remettre en cause les structures qui l’alimentent ?
Et nous, les militant·es de terrain, encarté·es ou pas — que voulons-nous faire de cette marque de défiance qui nous concerne, nous aussi ? Continuer à défendre nos “maisons” et “couleurs” et la laisser se retourner en désespoir ou en repli ? Ou en faire le point de départ d’autre chose : un autre type d’espace politique, plus lent peut-être, mais plus enraciné, plus horizontal, plus honnête, bien plus en contact avec le quotidien des gens qu’à l’écoute des centrales et directions et avec la stratégie électoraliste comme seul horizon?
Rien ne garantit que ces chemins aboutiront. Mais ce qui est sûr, c’est qu’aucun renouveau ne pourra advenir sans poser ces questions. Et surtout : sans cesser de croire qu’il faut à tout prix reconquérir le pouvoir tel qu’il est, voir oser en imaginer d’autres.