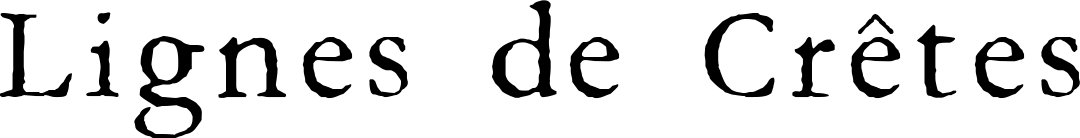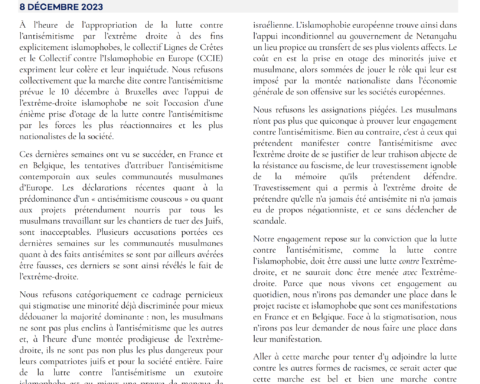Les 7 et 8 janvier, la Cour d’Appel de Paris rejugera Elias d’Imzalène.
Deux journées d’audience pour quelques phrases prononcées en manifestation. Deux journées pour décider si une parole militante relève de l’expression politique ou de la menace pénale.
Ce procès en appel ne porte pas seulement sur des mots. Il porte sur qui a le droit de les prononcer, et à quel prix. Il porte sur la transformation progressive d’un activiste des droits humains en ennemi intérieur.
Ce qui est jugé aujourd’hui, c’est une parole qui, en septembre 2024, a nommé ce que beaucoup refusaient encore de dire — et qui l’a fait trop tôt, depuis une identité immédiatement illégitime : celle d’un militant musulman.
Depuis, pourtant, les lignes ont bougé.
De plus en plus de voix, issues d’horizons différents, affirment publiquement que ce qui se passe à Gaza porte bien le nom de génocide. Des ONG, des juristes, mais aussi des figures intellectuelles et culturelles dont la légitimité est largement reconnue dans le monde occidental.
Parmi elles, celle de Omer Bartov, historien de la Shoah, professeur émérite à l’université Brown, spécialiste reconnu des crimes de masse. À l’été 2025, dans une tribune publiée en une du New York Times, il affirme explicitement que ce qui se déroule à Gaza relève du génocide. Cette prise de position est majeure : elle émane d’un chercheur qui a consacré sa vie à l’étude de la destruction des Juifs d’Europe et qui, longtemps, s’est montré prudent dans l’usage de ce terme.
Cette évolution traverse aussi le champ culturel. Art Spiegelman, auteur de Maus — œuvre fondatrice de la culture populaire contemporaine sur la Shoah, l’une des plus connues et des plus respectées mondialement — a lui aussi pris position. À travers des initiatives artistiques et des expositions de bande dessinée, il dénonce l’instrumentalisation de la mémoire de la Shoah et la violence en cours à Gaza.
Ces voix sont tardives — mais elles existent désormais. Elles montrent qu’Elias d’Imzalène n’était ni isolé, ni délirant, ni extrémiste. Il disait, dès septembre 2024, ce que des historiens, des intellectuels et des figures culturelles majeures de la lutte contre l’antisémitisme affirment aujourd’hui, enfin, ouvertement.
La différence est ailleurs.
Lorsqu’Omer Bartov écrit dans le New York Times, lorsqu’Art Spiegelman parle ou expose, leur parole est discutée, parfois contestée, mais elle n’est pas criminalisée. Elle n’entraîne ni garde à vue, ni procès, ni gel des avoirs.
Lorsqu’Elias d’Imzalène parle, en revanche, il est un homme musulman, militant, visible, issu d’une communauté déjà suspectée. Et c’est ce fait — bien plus que ses mots — qui l’a conduit devant une Cour d’Appel.
Le point de départ : une parole criminalisée.
Le 8 septembre 2024, place de la Nation, Elias d’Imzalene appelle à une « insurrection des consciences ». Il s’exprime dans un contexte d’extrême violence à Gaza : bombardements massifs, effondrement humanitaire, famine documentée, morts quotidiennes.
À ce moment-là, le débat public français est verrouillé. La solidarité avec la Palestine est assimilée à une transgression. Les mots sont traqués, isolés, surinterprétés. L’appel à l’« intifada » — entendu par lui comme un soulèvement des consciences contre la position du gouvernement français — devient le cœur d’un dispositif pénal et médiatique disproportionné.
Le premier crime : avoir eu raison trop tôt, et avoir organisé.
Le premier crime d’Elias d’Imzalene est d’avoir eu raison trop tôt. Mais il est surtout d’avoir organisé.
Elias d’Imzalene n’est pas un militant solitaire. Il fait partie de celles et ceux, nombreux, qui ont contribué à la création du collectif Urgence Palestine, un collectif qui a posé une ligne claire : replacer la parole palestinienne au centre de la mobilisation, refuser qu’elle soit confisquée, neutralisée ou rendue acceptable à condition d’euphémiser l’horreur coloniale.
Urgence Palestine a émergé dans un contexte de répression assumée. À l’automne 2023, le ministre de l’Intérieur soutenait l’interdiction des manifestations pro-palestiniennes. Malgré cela, la jeunesse est descendue dans la rue. Le collectif a permis de structurer cette mobilisation, de la rendre visible, massive, durable, puis d’entraîner l’ensemble des forces de gauche et de défense des droits humains.
C’est cette capacité à faire masse, à rendre la solidarité impossible à ignorer, qui n’est pas pardonnée.
La sanction pénale : une disproportion assumée
Elias d’Imzalene est poursuivi, jugé, condamné.
Le 19 décembre 2024, il écope de cinq mois de prison avec sursis pour provocation publique à la haine ou à la violence.
Dans son discours, il ne prononce pas le mot « juif ». Il n’appelle à aucune violence contre des personnes. Il appelle à la mobilisation contre ce qu’il désigne comme un génocide et contre l’alignement du gouvernement français.
La double peine : punition pénale et punition administrative
La répression ne s’arrête pas au tribunal.
En janvier 2025, un arrêté de gel des avoirs est publié au Journal officiel. Cette mesure est renouvelée.
Ce renouvellement n’est pas lié à un fait nouveau, mais à une continuité : Elias d’Imzalene a continué à s’engager publiquement.
Le gel devient alors un outil de pression politique. Il ne sanctionne pas un acte passé : il punit une persistance.
Concrètement, cela signifie un compte bloqué, une dépendance matérielle forcée, l’impossibilité de vivre et de se défendre normalement. La répression ne vise plus seulement la parole : elle organise une asphyxie et la mort sociale.
Une constance militante de terrain
Avant d’être un nom dans un dossier judiciaire, Elias d’Imzalene est un militant de terrain.
Il a été présent dans toutes les mobilisations antiracistes, et dans toutes les manifestations pour la Palestine, y compris les plus petites, celles qui n’attirent ni caméras ni tribunes.
Il est également présent aux côtés d’autres luttes sociales. Il était notamment au grand meeting du 15 novembre aux Invalides, organisé pour l’anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Un mouvement oublié de tous les politiques, qui ne rapporte plus rien à ses soutiens, si ce n’est le respect de ses propres principes, parmi lesquels la justice sociale universelle.
Une stratégie plus large
Elias d’Imzalene n’est pas un cas isolé.
Omar Al Soumi a lui aussi été visé par des poursuites, une stigmatisation médiatique et un gel de ses avoirs.
À travers eux, une stratégie se dessine : transformer des figures de mobilisation en exemples dissuasifs.
Le second crime d’Elias d’Imzalene est en effet d’être un homme musulman assumé.
Comme d’autres leaders de la solidarité avec la Palestine, il n’a pas pris la parole pour récupérer une cause, mais pour encaisser les coups. Depuis plus de deux ans, ces coups visent aussi une communauté musulmane systématiquement suspectée, sommée de prouver sa loyauté, régulièrement frappée d’indignité nationale.
Dans le climat politique actuel, où La France insoumise est accusée d’accepter un prétendu entrisme religieux, Elias d’Imzalene est construit comme une incarnation de cette menace fantasmée.
La tenaille
D’un côté, on reproche aux hommes musulmans de ne pas s’intégrer, de rester à l’écart des luttes sociales.
De l’autre, lorsqu’ils s’y engagent, ils sont accusés d’« entrisme ».
Cette double injonction ne laisse qu’une issue : le silence ou la destruction.
Ce procès dépasse largement Elias d’Imzalène.
Il concerne l’ensemble des musulmans et musulmanes de ce pays, mais aussi tous les activistes pour les droits humains. Il teste une limite : jusqu’où peut-on aller, en France, pour réduire au silence celles et ceux qui nomment un crime de masse ?
Voilà ce qui est en jeu : transformer un activiste des droits humains en ennemi intérieur — et, à travers lui, adresser un avertissement à tous les autres.